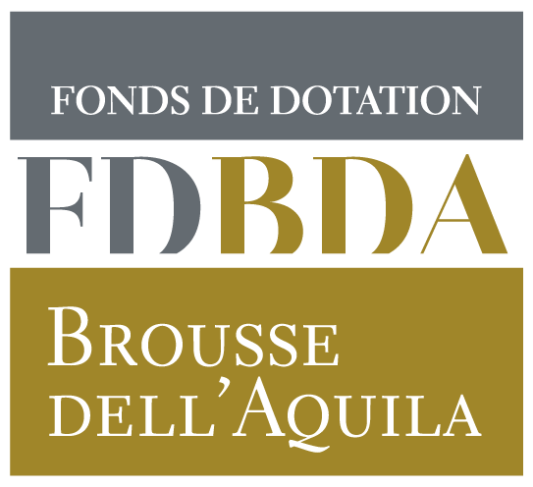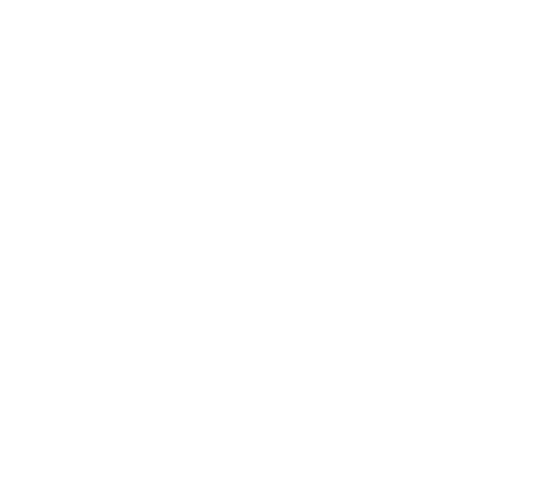Emmanuel Véron, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) – USPC et Emmanuel Lincot, Institut Catholique de Paris
Le grave accident écologique récemment survenu dans l’Arctique russe en pleine pandémie de Covid-19 aura laissé la communauté internationale plutôt indifférente. Cette crise environnementale s’ajoute pourtant au réchauffement climatique qui, d’ici quelques décennies seulement, libérera totalement cette région des glaces en été. L’accès aux ressources naturelles devient de plus en plus aisé, ce qui engendre une véritable bataille pour l’Arctique dans laquelle la Chine entend bien jouer un rôle majeur.
Il en va de même dans l’Antarctique où Pékin remet systématiquement en cause l’hégémonie occidentale. Un enjeu de taille, de nature non seulement environnementale mais aussi stratégique, qui ne manquera sans doute pas d’être abordé lors des prochains sommets Chine/UE et bien sûr lors de la COP-26 qui aura lieu en 2021.
Dans les régions polaires, quasiment vides d’hommes et d’infrastructures, ce qui attise la compétition interétatique, Pékin met plusieurs fers au feu : recherche scientifique, diplomatie et influence, investissements dans l’extraction, tourisme et développement du programme spatial…
L’Arctique : nouvel enjeu de la géopolitique mondiale
Ce n’est qu’au début des années 1990 que la RPC se met à manifester un intérêt concret pour la région en rappelant que le traité du Svalbard, signé au début des années 1920, autorisait ses signataires, à l’exception notable de la Chine, à conduire des activités civiles (pêche, tourisme, chasse, industrie et recherche scientifique) dans cette partie de l’Arctique norvégien. En 2004, la Chine y ouvrira la station de recherche Huanghe (du nom du fleuve Jaune), à Ny-Ålesund.
Territoire lointain, l’Arctique est un espace particulier dans le logiciel de la politique internationale de la Chine. Le Conseil de l’Arctique, fondé au lendemain de la Guerre froide, est l’institution principale de cette région qui recouvre 21 millions de kilomètres carrés. Elle regroupe en son sein huit États (le Canada, le Danemark, les États-Unis, l’Islande, la Norvège et la Russie, la Finlande et la Suède), à quoi s’ajoute une zone internationale située au cœur même de l’océan Arctique.
En 2018, faisant suite au Japon et à la Corée du Sud, Pékin publie un Livre blanc sur l’Arctique. Le régime se montre alors assez discret sur ces questions et soucieux de ne pas trop éveiller le ressentiment des autres puissances, la Chine, très éloignée géographiquement du pôle Nord, ne semblant pas légitime à prétendre y devenir un acteur de premier plan. La formulation chinoise qualifie la zone de « région voisine » et appelle simplement à « utiliser les ressources de l’Arctique d’une manière légale et rationnelle » et à « promouvoir la paix et la stabilité dans l’Arctique ».
L’activisme diplomatique actuel est précédé par le développement d’un intérêt croissant de la Chine pour les régions polaires en matière scientifique. Dès la fin des années 1980, les autorités chinoises lancent un programme officiel de recherche basé à l’Académie des sciences à Shanghai. Une revue scientifique (Chinese Journal of Polar Research), des partenariats institutionnels – notamment européens – et de premières expéditions poseront les bases de la stratégie chinoise dans les régions polaires.
La rivalité entre les puissances concerne tout d’abord les hydrocarbures. Il faut dire que les prometteuses réserves de l’Arctique sont à même de nourrir les appétits des majors du secteur et des États côtiers. Alors que les réserves mondiales de pétrole et de gaz s’épuisent, les réserves de l’Arctique sont estimées à près de 90 milliards de barils de pétrole, soit 15 % des réserves mondiales, et à 47 milliards de mètres cubes de gaz, soit 30 % du volume mondial total. Même si elles restent aujourd’hui difficiles à exploiter, ces ressources pourraient à terme « prendre la relève dans les années 2030, lorsque les ressources non conventionnelles seront épuisées ».
Il existe toutefois des alternatives à l’exploitation des énergies fossiles comme la géothermie ou l’éolien. Il est par exemple intéressant de noter la création d’un projet énergétique visant à relier l’Islande au réseau électrique européen via la Grande-Bretagne. Ces alternatives paraissent naturellement plus sûres en termes de préservation des ressources halieutiques. Il faut d’ailleurs noter que l’UE reste très dépendante de l’Arctique, qui lui fournit près de 25 % de ses importations de pêche, plus d’un tiers de son pétrole et deux tiers de son gaz.
Outre les projets scientifiques chinois aux pôles et sa diplomatie d’influence, Pékin a investi dans le secteur de l’extraction (mines et hydrocarbures), plus particulièrement au Groenland, en Russie, ou encore au Canada, mais aussi dans celui des infrastructures. La visite d’État de Xi Jinping en Finlande en 2017 atteste de l’importance accordée à la zone.
La Chine a la volonté de développer des infrastructures s’étendant de Kirkenes en Norvège à Varsovie via la Scandinavie et les pays baltes, mais aussi au Groenland. Elle cherche à sanctuariser des points d’appui et des réserves de terres rares (parmi d’autres richesses minières). Cette logique d’investissement inquiète beaucoup Washington ainsi que certains pays riverains placés sous la pression américaine. Le montant des investissements chinois dans l’espace polaire aurait atteint près de 90 milliards de dollars entre 2005 et 2017 selon l’institut américain Center for Naval Analyses.
On l’a dit, l’intérêt de la Chine pour cette aire géographique s’est traduit dès les années 1980 par un vaste activisme scientifique. Cette « diplomatie de la recherche » s’est, dans un deuxième temps, appuyée sur le partenariat stratégique qu’elle a noué avec la Russie, laquelle contrôle la moitié des côtes arctiques (22 600 km). Les enjeux sont considérables : créer une alternative au dilemme de Malacca en ouvrant une voie maritime septentrionale, et permettre aux SNLE et SNA russes et chinois d’en sécuriser l’accès.
La récente révélation du fait que l’ancien patron russe de l’Académie des sciences de l’Arctique, Valery Mitko, travaillait pour la Chine a montré l’ancienneté de l’intérêt de Pékin pour la région, notamment pour l’évolution de ses sous-marins dans ses eaux polaires (plus particulièrement l’hydroacoustique et les technologies de détection des sous-marins).
Ces enjeux expliquent la volonté de Moscou d’étendre la ZEE russe sur 1,2 million de km² recelant d’énormes ressources pétro-gazières. En somme, ces revendications russes sont symétriques à celles de Pékin en mer de Chine. Que la RPC soutienne, dans bien des domaines, les positions de Moscou se justifie d’autant plus que l’un des principaux objectifs de Xi Jinping consiste à assurer la sécurité énergétique de son pays (qui importe entre 70 et 85 % de ses approvisionnements en hydrocarbures). En 2013, la Chine (ainsi que plusieurs autres pays dont la France) a signé un accord d’extraction et de liquéfaction du gaz dans la péninsule de Yamal. La RPC sera l’investisseur (à travers la China National Petroleum Compagny et un fonds des « routes de la soie polaire ») le plus important dans la zone et dans la construction de site industriel immense de Sabetta.
L’autre cause de l’intérêt de la Chine pour la région est sa volonté de garantir sa sécurité alimentaire qui lui défaut chaque année davantage. La RPC représente, en effet, 20,5 % de la population mondiale mais 9 % seulement des terres arables et 6,5 % seulement des réserves en eau. L’accès à l’océan Arctique est donc vital pour elle. 95 % de ses exportations se font par la voie maritime, l’Union européenne demeurant son premier partenaire commercial.
Pour ce faire, sa stratégie reste invariablement la même : s’appuyer sur de petits pays. C’est ainsi qu’elle a signé en 2013 un accord de libre-échange avec l’Islande (le premier entre un État de l’UE et la Chine) et est devenue, avec le soutien diplomatique de Reykjavik, membre observateur permanent du Conseil de l’Arctique, ce qui lui permettra entre autres de développer un observatoire dans le nord de l’île à Kárhóll.
Trois ans plus tôt, c’est le Danemark qui avait été approché dans la même optique. Cela n’est pas anodin, car le Groenland, pays constitutif du Danemark, est le lieu le plus sensible de la confrontation entre le duo Chine/Russie d’une part et les États-Unis de l’autre. Cette rivalité maritime ne doit pas être sous-estimée même si elle se trouve relativisée par les dimensions cybernétique, aérospatiale et aérienne. Ces derniers aspects invitent à aborder les problèmes des pôles et les rivalités auxquelles se livrent les puissances sous un angle particulier : celui de l’aéro-stratégie.
Aéro-stratégie et logique de rivalités en Antarctique
Depuis Paul Virilio, on sait que l’alliance de la vitesse et de la technologie a conduit l’humanité vers une ère nouvelle, la « dromosphère ». D’où une conception de la stratégie conférant une place majeure à l’aérien et à ses multiples moyens, que ce soit dans l’utilisation des aéronefs ou des arsenaux balistico-nucléaires.
De cette aéro-stratégie, il résulte une cartographie non plus latitudinale (est-ouest) mais longitudinale (nord-sud) dont l’Arctique est le centre d’après une projection cartographique polaire. Mais il est un autre couloir d’une zone plus périphérique encore qui pourrait être amené, dans la partie méridionale de l’océan Indien, à jouer un rôle majeur : c’est celui qui relie l’Amérique du Sud à l’Australie via l’Afrique, à travers l’hémisphère sud. C’est-à-dire dans des régions riveraines de l’Antarctique. Ce dernier, comme la région polaire septentrionale, tient une place particulière dans le programme spatial chinois. En 2018, Pékin a organisé une communication très précise au sujet du déploiement d’une future station de réception au sol d’un système dual de télédétection spatiale Beidou-3.
Cet attrait pour le « continent blanc » (14 millions de kilomètres carrés) exacerbe d’ailleurs les convoitises territoriales et cela, en dépit de son statut international (défini par le traité du 1ᵉʳ décembre 1959 complété par le protocole du 4 octobre 1991). La Chine y développe ses initiatives diplomatiques, qui sont pour l’heure largement subordonnées au positionnement stratégique de pays qu’elle convoite sur le continent sud-américain tels que l’Argentine et le Chili. La RPC s’appuie sur la proximité géographique de ces deux États et sur la forte interdépendance économique qu’elle entretient avec eux.
Au total, la Chine développera cinq stations en Antarctique. Pékin a installé quatre stations en Antarctique depuis le début des années 1980 (la Grande Muraille en 1985, Zhongshan en 1989, Kunlun en 2009 et Taishan en 2014) ; la cinquième est en cours de construction sur l’île Inexpressible baignée par la mer de Ross. Pékin a acheté en 1993 un navire brise-glace à l’Ukraine, qui sera restauré et nommé Xuelong (Dragon des neiges). Symbole par excellence de la présence chinoise dans les eaux polaires, ce navire imposant (pouvant déplacer plus de 20 000 tonnes) participera à plusieurs dizaines de missions (la majorité au Pôle Sud) dans le cadre de recherches mais aussi de ravitaillement des points d’appui chinois aussi bien dans l’Arctique qu’en Antarctique.
Le sistership, Xuelong 2, a été inauguré en 2019. Un troisième navire brise-glace, cette fois nucléaire, est en projet. Ces navires scientifiques sont le prolongement des activités de pêche chinoises (les plus importantes au monde) en particulier dans cette zone australe très riche en krill et en légine.
La présence chinoise en Antarctique et en Arctique est un enjeu géopolitique très important pour le développement du programme spatial de Pékin, pour la sanctuarisation de zones de pêche, mais aussi, plus discrètement, pour l’avenir du traité sur l’Antarctique de 1959. Ce dernier fixe les règles de la gouvernance internationale de la zone. La RPC s’intéresse à l’ensemble de cet espace, plus particulièrement à la zone orientale (revendiquée par l’Australie et la France) et pourrait, à terme, affirmer sa souveraineté sur un espace qui demeure pour l’instant un espace commun. On l’aura compris : les pôles feront à l’avenir l’objet d’une convoitise toujours plus exacerbée dans le contexte de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine…
Emmanuel Véron, Enseignant-chercheur – Ecole navale, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) – USPC et Emmanuel Lincot, Spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut Catholique de Paris
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.