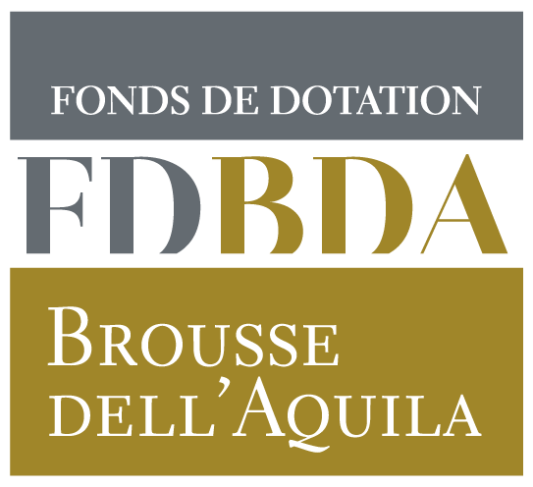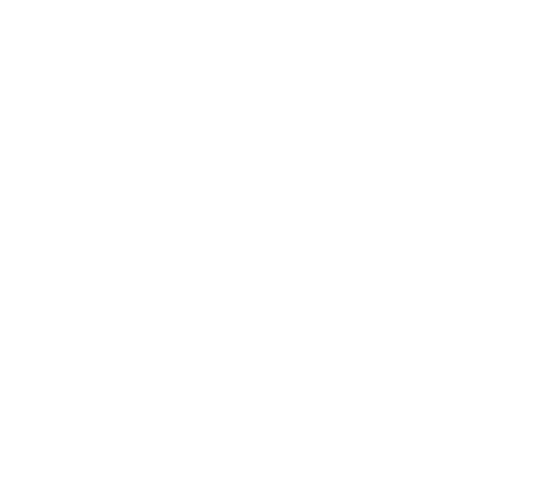Petit Etat d’Asie du Sud, la République populaire du Bangladesh (ex Pakistan oriental), issue de la dislocation des Indes en 1947, proclame son indépendance du Pakistan en 1971. Pays densément peuplé largement structuré par le delta et la confluence du Gange et du Brahmapoutre, le Bangladesh est géographiquement enclavé dans l’Inde et possède une très modeste frontière commune avec la Birmanie. Peuplé par plus de 170 millions d’habitants, le PIB s’élève à 400 milliards de dollars en 2023, faisant du pays l’un des pays d’Asie classé dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA), dont il devrait sortir, en 2026, suivant la confirmation de reclassement par le PNUD en 2021. Le développement du pays est rapide. La croissance est forte de 7 % par an depuis une décennie, largement tirée par l’industrie textile et l’ouverture du marché européen à ses produits. Une large partie de la production économique[1] vient d’une part, des services (plus de 50 % du PIB), de l’autre du secteur agricole et des matières premières. L’industrie textile fait figure de singularité, en particulier du tournant des années 2000 à la crise du secteur avant la pandémie de Covid-19.
Le contexte géographique et politique du Bangladesh (Inde/Pakistan et géographie de l’Asie du sud ouvrant sur l’Asie du sud-est) a induit un rapprochement politique et économique de la Chine, indépendamment de la scission avec le Pakistan, très proche de Pékin. La politique chinoise dite de « bon voisinage » et de géopolitique du « pourtour », c’est-à-dire, de la montée en puissance de sa présence diplomatique, commerciale et militaire en Asie, a noué des liens importants avec un Etat de taille très modeste, sans être frontalier, mais dans le giron indien et ouvrant sur l’Océan indien. En ce sens, les relations entre la Chine et le Bangladesh sont majeures et structurantes sur les 25 dernières années, sinon plus, en particulier d’un point de vue commercial, économique et industriel. La sphère d’influence de la Chine s’était considérablement élargie venant recouper celle de l’Inde et sa proximité entretenue avec le Bangladesh.
Un partenariat économique bilatéral majeur et une relation très asymétrique
Entre 2005 et 2024, le volume global des investissements chinois au Bangladesh s’élève à près de 34 milliards de dollars, diversifiés dans les infrastructures et la construction, l’énergie, les transports, la chimie et les technologies. Au début de l’été 2024, Pékin et Dacca ont élevé leur relation à un niveau inédit, celui de « partenariat de coopération stratégique global », un mois avant la débâcle politique et la fin de règne de la première ministre bengali Sheikh Hasina[2] (après 15 ans au pouvoir). Ce niveau de partenariat est réhaussé depuis 2016, alors partenariat stratégique, visant à conforter la présence chinoise dans la région, notamment dans la diversification des approvisionnements en matières premières, l’investissement chinois dans de grands projets et l’élargissement de la coopération bilatérale. Les flux d’IDE se sont accélérés ces dernières années, mais restent bas, notamment liés à la croissance des IDE chinois, bien que les Etats-Unis demeurent le premier investisseur (à hauteur de 4,2 milliards de dollars). Pékin est le principal fournisseur du Bangladesh (23%), suivi par l’Inde (15%), puis la Malaisie (5%). La Chine est le premier partenaire commercial du Bangladesh, avec des échanges bilatéraux totalisant 168,4 milliards de yuans (23,6 milliards de dollars) en 2023, dont 161,1 milliards de yuans d’exportations chinoises vers le Bangladesh. Les réserves de devises étrangères du Bangladesh sont soumises à une pression importante en raison du déficit commercial avec la Chine.
La balance commerciale du Bangladesh est déficitaire, en faveur de la Chine. Pour exemple, en 2022, le Bangladesh importait pour une valeur de 27 milliards de dollars de produits. Ces derniers sont très variés, des biens manufacturés, principalement des produits textiles, des produits de métaux transformés, et autres produits pétrochimiques. La même année, Pékin importait du Bangladesh 952 millions de dollars, essentiellement des produits et matières premières, liés à l’industrie du textile (fil de jute), des produits textiles, des peaux, des malles etc. Le développement du secteur, notamment textile, a été largement induit par la hausse des salaires et l’évolution du secteur en Chine, après la crise des subprimes (2008-2009). Le faible coût de la main d’œuvre et le déploiement des investisseurs de la filière en Asie du sud-est (Vietnam et Cambodge) et du sud (Bangladesh) ont suscité l’implantation structurante du textile à Dacca et dans le réseau de villes secondaires (Gazipur ou Chittagong). Les grands consortiums internationaux du textile installés au Bangladesh sont en parties articulés aux acteurs chinois du secteur. Aujourd’hui, Pékin importe beaucoup du Bangladesh, à la fois des articles mais également des produits pour la fabrication (textiles et cuirs).
Si le domaine des transports, de l’énergie, des technologies sont les plus importants et surreprésentés, avec des montant dépassant 200 millions de dollars, parfois 1 milliard de dollars, les acteurs chinois du tourisme, de l’agriculture, des services publics (utilities) ou de la finance ont également réalisé plusieurs opérations. Pour exemple, en 2011, la State Development and Investment Corporation a réalisé un investissement de 590 millions de dollars dans l’agriculture. En 2015, PowerChina investit 1,5 milliard de dollars dans les infrastructures de transport. En 2016, dans l’énergie, respectivement, China Energy Engineering et China General Technology investissent chacun 990 millions de dollars, ou encore Sinomach à hauteur de 1,1 milliard de dollars. Plus tard, en 2018, China Railway Engineering investira 2,7 milliards de dollars. La même année, le consortium Kunming Iron investira 2,1 milliards de dollars. Plus récemment, en 2024, State Construction Engineering a investi 110 millions de dollars et China National Chemical Engineering 260 millions de dollars. La grande majorité des 34 milliards de dollars investis au Bangladesh depuis 2004 sont réalisés entre 2015 et 2024, concomitamment au projet Belt and Road Initiative.
Le Bangladesh, exemple type du projet « Belt and Road Initiative » ?
Le Bangladesh est l’un des premiers pays[3] à rejoindre officiellement le projet chinois Belt and Road Initiative (BRI) en 2016. A chaque forum BRI à Pékin (2017, 2019 et 2023), le Bangladesh est ainsi à l’honneur et largement valorisé par la diplomatie chinoise.
Attiré par les prêts chinois pour des projets d’infrastructures de grande envergure qu’il ne pouvait pas se permettre de financer seul (routes, voies ferrées, lignes électriques et réseaux de communication, ports maritimes ou encore le premier tunnel de transport sous la mer d’Asie du Sud), le gouvernement bengali, en premier lieu, la Première ministre Hasina a arbitré un rapprochement de la Chine au travers de la BRI. Afin de marquer ce rapprochement, et de valider l’initiative chinoise, Xi Jinping effectue une visite d’Etat en 2016. Le projet BRI s’articule à l’initiative du corridor BMIC-EC (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor). Remontant à 1999, le BMIC-EC vise à favoriser une intégration régionale et la connectivité entre la Chine et l’Inde par les deux Etats intermédiaires et dans la sphère d’influence réciproque des deux géants asiatiques[4]. Depuis, la diplomatie chinoise rappelle l’importance du projet BRI au Bangladesh, aussi pour contrecarrer l’image écornée d’un projet global qui a montré ses limites et fragilisé des économies déjà très vulnérables. Pour exemple, l’ambassadeur de Chine au Bangladesh Yao Wen déclarait que la Chine a construit « 12 routes, 21 ponts et 27 projets d’électricité et d’énergie » au Bangladesh tandis que les entreprises chinoises ont créé plus de 550 000 emplois dans le pays. Ceci est en écho à plusieurs réalisations ou projets qui ont pu alimenter une polémique au Bangladesh, notamment sur la viabilité de grandes infrastructures.
Mêlé à des affaires de corruption importante, la Banque mondiale a suspendu un projet de financement en 2012, le pont de Padma (reliant Dacca au sud du Bangladesh), dans lequel le parti de Sheikh Hasina, la Ligue Awami, aurait eu une implication. Parallèlement, plusieurs entreprises chinoises ont dans un sens pris le relais, poursuivant le projet via une route secondaire, et diverses infrastructures. Dans la continuité de cette implantation économique et d’un réseau d’entreprises chinoises dans la construction, en 2023, le Bangladesh a inauguré le tunnel de Karnaphuli, soutenu par Pékin, une liaison routière de 3,2 km sous la rivière Karnaphuli dans la ville portuaire de Chittagong, construite par China Communications Construction Company.
L’Exim Bank (l’un des principaux instruments de la BRI et des financements colossaux à l’international de la Chine) a assuré la moitié du montant d’un 1,1 milliard de dollars. Les opérateurs bancaires Bank of China, China Development Bank, Agricultural Bank of China et l’ICBC sont eux aussi présents dans le financement de projets au Bangladesh. De telles infrastructures ne vont pas sans induire des polémiques et revendications au sein du paysage politique bengali et des opinions. Le tunnel de Karnaphuli a suscité de nombreuses interrogations sur sa nécessité, alors que plusieurs priorités en matière de développement sont pointées par le PNUD. A l’opposé, les partisans bengalis du projet et la diplomatie chinoise rappelaient que le projet stimulerait la croissance, l’emploi et les échanges commerciaux entre les zones d’exportation du Bangladesh et une zone économique exclusive chinoise dans la région voisine d’Anwara. Deuxième ville du pays, Chittagong est le principal port national et régional. Jumelée avec la Kunming (préfecture de la province du Yunnan), Chittagong constitue l’un des relais portuaires identifié dans le cadre du « collier de perles » chinois par les analystes et milieux stratégiques américains, japonais et indiens. Le développement d’une politique maritime d’une part, et l’insertion dans la mondialisation ont suscité l’investissement d’acteurs chinois du maritime, notamment dans l’aménagement et la gestion de ports internationaux. Chittagong est de ceux-là. Le développement chinois des activités portuaires répond à plusieurs logiques : commerce, déploiement diplomatique, points d’appui tactique au service d’une stratégie d’ambition globale. Ainsi, comme dans divers ports d’Asie (Cambodge, Sri Lanka, Afrique de l’est ou de l’ouest etc.), Chittagong possède un usage dual, civil/commercial et de portée militaire (comme relais et point d’appui logistique) en complément de moyens militaires.
Contraindre la sphère d’influence indienne, développer une arrière-cour chinoise
La relation bilatérale sino-bengalie très asymétrique est nourrie par l’ambition chinoise de prendre pied dans l’environnement géographique immédiat de l’Inde. Géographiquement favorable avec une ouverture sur l’Océan indien, zone charnière entre l’Asie du sud-est et l’Asie du sud, le Bangladesh, économiquement fragile, représente une priorité stratégique chinoise à l’instar d’autres Etats du pourtour indien. De la Birmanie au Pakistan, en passant par le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, les Maldives et le Sri Lanka, la rivalité sino-indienne participe pleinement des turpitudes politiques nationales (Etat par Etat) en plus des réalités locales et des influences internationales (commerciales, normatives, climatiques, conflits etc.). Aussi, l’agenda diplomatique du Bangladesh poursuit une volonté de rejoindre l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) en tant que pays observateur ou partenaire de dialogue. D’autre part, En 2023, le Bangladesh a formulé officiellement le vœu de rejoindre les BRICS +. Ainsi, le rapprochement sino-bengali et l’importance que revêt la Chine pour Dacca influence sa politique étrangère. Le troubles politiques au Bangladesh et la fuite de la Première ministre Hasina en Inde provoqueront-ils une recomposition des relations sino-bengalies ? L’année 2025 marquera le 50e anniversaire de l’établissement des liens diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République populaire du Bangladesh. La visite d’Etat de Sheikh Hasina en juillet dernier à Pékin venait initier cette date anniversaire.
L’économiste et prix Nobel de la Paix, Muhammad Yunus (84 ans) assure l’intérim du pouvoir à Dacca. La position de Yunus a été salué par les Etats-Unis, l’Union européenne mais également par la République populaire de Chine. Dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, Pékin déclarait en août dernier : « La Chine respecte la voie de développement choisie en toute indépendance par le peuple bangladais » et est prête à travailler avec le nouveau gouvernement. » Muhammad Yunus connaît bien la Chine et inversement. Il a notamment participer à des développements de micro-crédits en Chine. Rapidement, Yunus a publiquement encourager la consolidation des liens économiques entre les deux pays, notamment à travers le secteur de l’énergie et la demande de relocalisation des usines de panneaux solaires.
Emmanuel Véron
Initialement publié dans La Lettre de Chine hors les murs n°61 – septembre 2024.
[1] En 2022, les secteurs de la production économique au Bangladesh sont répartis comme suit : secteur primaire à 12 %, le secteur secondaire à 37 % et le secteur des services à 52 %.
[2] Sheikh Hasina a fui sa résidence officielle de Dacca pour se réfugier en Inde à New Dehli.
[3] Le Bangladesh est le premier pays d’Asie du Sud.
[4] L’initiative BMIC est évaluée à 22 milliards de dollars : projets énergétiques, infrastructures de transport, commerce, développement humain et lutte contre la pauvreté. Un projet d’autoroute entre Kunming et Calcutta (long de 2800 km) constituerait la colonne vertébrale du corridor. Le BMIC prendra un certain essor politique après la visite de feu le Premier ministre Li Keqiang en 2013 en Inde, où un groupe d’étude sera constitué.