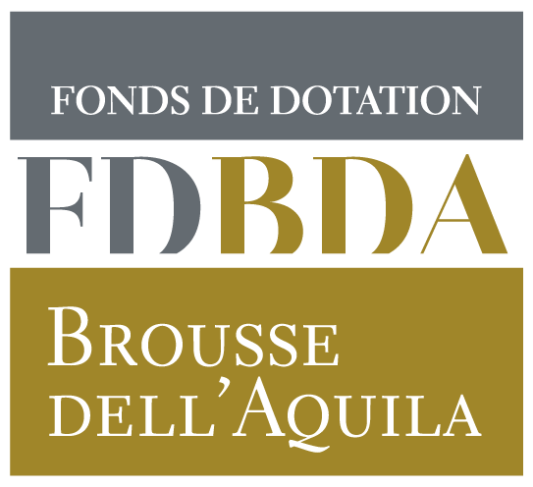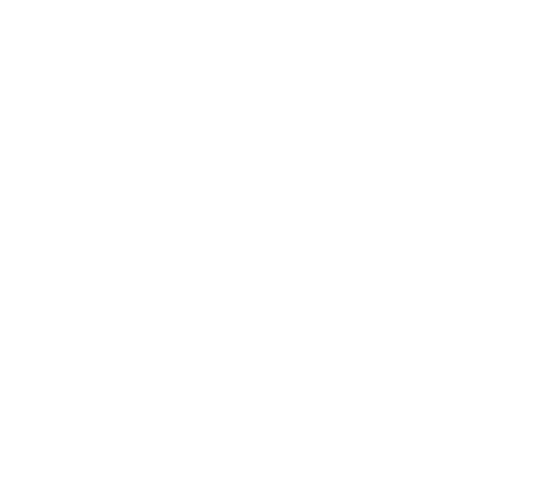CHINE – TURQUIE : DE L’ASYMÉTRIE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
AUX ENJEUX STRATÉGIQUES RÉGIONAUX
Pays membre de l’OTAN, en difficulté économique chronique (crise monétaire, inflation, chômage, dépendance forte de ses exportations, etc.), la Turquie est animée d’une ambition géopolitique régionale forte et structurante, dépassant largement l’espace moyen-oriental. Géographiquement située entre l’Asie et l’Europe, la Turquie entretient des relations importantes avec la Chine (dans la perspective de la longue durée des échanges entre empires), qui a su lui donner une place singulière dans son agenda diplomatique et commercial. Outre sa position idéale sur l’itinéraire des « Nouvelles routes de la soie » (Belt and Road Initiative – BRI), Ankara a depuis deux décennies intensifié sa relation économique avec Pékin, tout autant que son statut de puissance régionale dans les instances internationales à l’instar de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) ou des BRICS +.
Une relation bilatérale nourrie d’ambitions réciproques, où chacun joue sa partition afin de maintenir et accroitre son influence régionale à la fois en Asie et au Moyen-Orient. Les deux Etats (non-occidentaux) se jaugent l’un l’autre pour assoir leur dessein au sein des mutations internationales, en dernière date la chute de Bachar Al-Assad et les recompositions stratégiques au Moyen-Orient.
Au-delà de la question ouïghoure, une relation bilatérale en forte croissance depuis les années 2000
Le sujet des populations ouighours (turcophones) a suscité à plusieurs reprises des tensions contenues entre Pékin et Ankara (année 1990, 2000 et plus récemment 2010). La présence sur le territoire turc de populations ouïghoures et la continuité ethnoculturelle turcophone a entretenu une forme de variable d’ajustement dans les relations turco-chinoises. La volonté de contrôle du Parti-Etat chinois en dehors de ses frontières des populations ouïghoures et de la reconnaissance de son « intégrité territoriale » ont été des facteurs constants et structurants de la politique étrangère de Pékin vis-à-vis de la Turquie (notamment par le truchement de la région du Xinjiang dans laquelle se sont déployées des zones d’investissements, des lignes aériennes avec Turkish Airlines, Sichuan Airlines, entre métropoles chinoises et turques, etc.). Au-delà de ce dossier diplomatique, la relation bilatérale s’est notamment densifiée en 2010, à l’occasion d’une visite de Wen Jiabao (ancien Premier ministre) en Turquie et de la promulgation du rehaussement de la relation au niveau d’un « partenariat stratégique ». La Turquie cherchant à diversifier ses partenariats et développer ses ambitions vers l’Asie au travers de la Chine.
La Chine s’est progressivement imposée cette dernière décennie comme le troisième partenaire commercial de la Turquie. En 2023, le volume total des échanges bilatéraux s’élève à 43, 4 milliards de dollars. Suivant la dynamique des surcapacités industrielles chinoises, Pékin cherche à étendre son influence commerciale au sein du marché turc, notamment avec les « trois technologies » (véhicules électriques, photovoltaïque, batteries) auquel s’ajoute le secteur des infrastructures. Les investissements chinois se concentrent de plus en plus sur la création d’installations de fabrication de véhicules électriques et de smartphones, tandis que les projets de collaboration dans les infrastructures énergétiques renforcent les capacités de la Turquie.
En quinze ans, le partenariat sino-turc a élargi son spectre des activités aux infrastructures et technologies, en passant par des équipements militaires. Cependant, la relation demeure déséquilibrée, à l’instar de la très grande majorité des partenariats avec Pékin, notamment en matière économique et commerciale.
Une relation économique très asymétrique au profit de Pékin
Entre 2005 et 2024, le montant total des investissements et contrats d’infrastructure (construction) chinois en Turquie s’élève à 18,70 milliards de dollars. Parmi les investissements et contrats majeurs chinois en Turquie, le secteur des transports est bien représenté. En 2005, les sociétés d’Etat China Railway Construction et China General Technology (Genertec) contractualisent un projet de construction ferroviaire et de métros des grandes villes pour un montant de 1 270 millions de dollars. Le secteur des transports est également illustré par un investissement dans l’automobile avec Chery Auto pour un montant de 120 millions de dollars en 2012. Le secteur énergétique est probablement celui qui concentre le plus de contrats chinois.
Sinomach développe un projet de 610 millions de dollars à compter de 2007, puis de 360 millions de dollars en 2010, la société Datong contracte un montant de 760 millions de dollars en 2008. L’année 2012 sera particulièrement importante avec PowerChina pour un montant 210 millions de dollars (poursuivi avec State Grid à hauteur de 1320 millions de dollars), China Electric Equipment à hauteur de 600 millions de dollars, China National Chemical Engineering pour 640 millions de dollars ou encore Harbin Electric à hauteur de 130 millions de dollars, suivi d’un nouveau projet en 2013 de 2400 millions de dollars (plus important projet chinois en Turquie). Le secteur énergétique continuera de se densifier, tant en matière d’exploitation que d’infrastructure (centrales électriques) et de distribution entre 2013 et 2024 au travers de l’ensemble des grandes sociétés d’Etat liées aux structures du régime afin de constituer des investissements stratégiques dans le cadre de sa politique étrangère notamment au Moyen-Orient. D’autres secteurs forment également les vecteurs majeurs de la politique internationale des sociétés d’Etat de Pékin, en particulier avec le développement immobilier (Sinoma à hauteur de 780 millions de dollars en 2010 puis 100 millions et 160 millions de dollars en 2015), ou l’industrie de la chimie et des métaux (810 millions et 350 millions de dollars dans deux projets respectivement de construction et d’investissement de la société China National Chemical Engineering en 2013 puis 160 millions de dollars en 2022).
Enfin, la finance, la logistique et les technologies ont connu un développement significatif après 2013. A titre d’exemples éloquents, Alibaba investit plus de 1100 millions de dollars entre 2018 et 2021, Bank of China et BAII investissent pour plusieurs centaines de millions de dollars en Turquie dans le cadre de la BRI. En 2023, le volume total des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 43,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,6 % par rapport à l’année précédente (42,08 milliards en 2022). Sur la même période, les exportations chinoises vers la Turquie se sont élevées à 39,07 milliards de dollars, tandis que les exportations turques vers la Chine ont totalisé 4,33 milliards de dollars. De janvier à août 2024, le volume des échanges bilatéraux entre les deux pays s’est élevé à 28,6 milliards de dollars. Ainsi, le commerce bilatéral est très déséquilibré. Les exportations de la Turquie vers la Chine ont connu une baisse entre 2022 et 2024.
Le commerce bilatéral sino-turc est structuré par les importations turques de biens de consommation et technologies (machines électriques, semi-conducteurs etc.) à hauteur de plus de 60 % du total d’une part, les matières premières turques (pierres, minerais et métaux – marbre, albâtre, plomb, chrome, cuivre, borax, etc.) à 60-70% des importations chinoises. Le reste est très diversifié au sein du tissu industriel chinois et turc dans le secteur du textile, de la chimie ou l’industrie des plastiques.
Les entreprises OPPO, Xiaomi, Transsion Holding ou Vivo ont toutes implanté des usines en Turquie. La société Transsion a annoncé vouloir investir 3 milliards de dollars sur une période de cinq ans pour la fabrication de téléphones portables, avec une première enveloppe de 500 millions de dollars engagée. Ces dynamiques économiques asymétriques (la Turquie a investi en Chine, notamment dans les grandes régions industrielles du Jiangsu ou du Guangdong) s’articulent à la dimension stratégique des ambitions des deux Etats dans le système international, d’affirmation de leur poids respectif à la fois régionalement et mondialement.
Les aspects stratégiques de la relation sino-turque
Si la Chine et la Turquie ont signé un traité bilatéral d’investissement en 1994, suivi d’une convention sur les taxes et droits de douanes en 1995, le commerce connaît un réel décollage au milieu des années 2000. En 2012, les deux pays signent un « swap agreement ». Pour Pékin, la Turquie est essentielle dans son dessein stratégique BRI pour assoir son influence politique, commerciale et technologique. Si la méfiance demeure et si la concurrence stratégique est marquée par les ambitions réciproques en Asie centrale ou dans le Caucase, Ankara et Pékin entretiennent un dialogue stratégique en dehors de la sphère occidentale.
Dès la fin des années 1990, la relation sino-turque est animée par un volet structurant de perceptions stratégiques réciproques, notamment au Moyen-Orient et plus largement en Asie. D’un côté, les ambitions turques sont marquées par une volonté de rayonnement post-impérial jusqu’en Asie, renouant avec l’espace turcophone ; de l’autre, la Chine a considérablement accru sa présence (tous azimuts) au Moyen-Orient. L’agenda politique turc a intensifié ses relations avec Pékin (surtout après 2010), en bilatéral mais aussi dans le cadre multilatéral des grandes organisations internationales non-occidentales comme l’OCS, les BRICS ou encore les forums et institutions d’initiative chinoise (Forum BRI, BAII, etc.). Géographiquement, la Turquie est favorablement positionnée pour Pékin, comme axe possible de contournement de la Russie pour atteindre l’Europe, notamment par voie ferroviaire.
En juillet 2024, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a rencontré le président chinois Xi Jinping lors du 24e sommet du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). La Turquie, qui a exprimé son souhait de devenir membre à part entière de l’OCS en 2022 ou des BRICS +, considère le renforcement des liens avec la Chine comme un aspect clé de son réalignement stratégique élargi. Inversement, Pékin ménage sa relation avec la Turquie, notamment en lien avec l’OTAN, mais également comme puissance régionale, qui avec et la chute du président Assad en Syrie à la fin 2024 recompose les équilibres pour l’ensemble du Moyen-Orient. Pékin souhaite demeurer autour de la table des négociations en tant que grande puissance (non régionale).
Alors que Pékin annonçait avec la Syrie un partenariat stratégique en 2023 (déplacement à Hangzhou des Assad – l’épouse Asma Al Assad étant impliquée dans des échanges de fonds BRI), le continuum favorable à Pékin (politiquement et stratégiquement) du Moyen-Orient de l’Iran à Damas est en cours d’effritement et de recomposition. Cependant, la posture chinoise au Moyen-Orient est sans commune mesure avec la Russie, tant le poids économique, diplomatique et technologique est diversifié à l’ensemble des pays avec une asymétrie suggérant une dépendance accrue à Pékin. Le nouvel homme fort de Damas, Ahmad al-Sharaa – connu sous son nom de guerre/Djihadiste d’Abu Mohammed al Julani, et Pékin ont pris contact. La Chine pourrait figurer comme un acteur de poids dans la reconstruction et conserver une position régionale afin d’être attentif au facteur sécuritaire et de maintenir indirectement sa rivalité avec la puissance américaine.
Emmanuel Véron
Initialement publié dans le Lettre de Chine hors les murs n° 63 – janvier 2025.